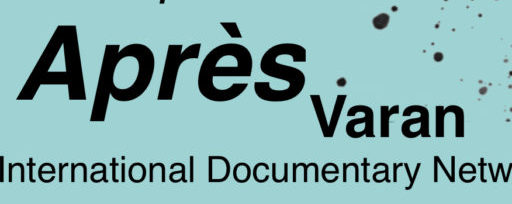Une maîtrise iconique de l’image et du récit
« 12 lessons » de Giorgi Mrevlshvili (Georgie, 2020)
On ne peut qu’être impressionné par la qualité du travail de Giorgi Mrevlishvili pour raconter le lien et la prise en charge d’un enfant autiste par son grand-père pourtant démuni, dans une campagne démunie.
Le tournage a lieu le plus souvent sous la pluie ou dans le froid dans un environnement désolé mais non désespéré, car le sens de la solidarité y a encore une part.
La force du détail suscite d’autant mieux l’attention du spectateur que l’oeil du réalisateur le sert comme sur un plateau au milieu d’un désert. Que ce soit à travers une vitre embuée d’une voiture ou un très gros plan sur un poing adulte serrant la main de l’enfant, il y a comme une maîtrise icônique de l’image dans la manière de filmer du réalisateur. Et une belle manière de resserrer les plans sur chaque thème exploré, tel l’apprentissage du parcours d’obstacles à bicyclette.
Les douze séquences du documentaire sont autant de mouvements filmiques qui assurent la réussite incontestable de 12 lessons.
Guy Lavigerie
An iconic mastery of image and narrative
One can only be impressed by the quality of Giorgi Mrevlishvili’s work to tell the story of the bond and the care of an autistic child by his helpless grandfather, in a destitute countryside.
Filming usually takes place in the rain or in the cold in a desolate but not desperate environment, because the sense of solidarity still has a part to play in it.
The strength of the detail arouses the viewer’s attention all the better as the director’s eye serves him as if on a set in the middle of a desert. Whether it’s through a fogged window of a car or a very close-up of an adult fist shaking the child’s hand, there is a kind of iconic mastery of the image in the director’s way of filming. And it’s a great way to tighten up the plans on each theme explored, such as learning the obstacle course on a bicycle.
The twelve sequences of the documentary are as many filmic movements that ensure the undeniable success of 12 lessons.
Guy Lavigerie
Comme une provocation au miracle social
« Ici on creuse » de Éva Pénot (France, 2023))
Ça commence bien, on est un peu surpris par l’abrupte lecture d’un texte sur un quai de RER mais on est dans le vif du sujet qui prend aussitôt le tour dynamique d’un défilé d’images industrielles bordant la voie entre la banlieue et Paris.
Puis on découvre en action le personnage central. Fahrid, bien plus que travailleur social, parle vite et net à ceux qui baissent les bras : « Moi je creuse et toi tu rebouches ! »
Éva Pénot a mis au point un dispositif rapproché de prises de parole brèves, face caméra, par plusieurs jeunes habitants du quartier. Le spectateur doit prendre le pouls de ces inserts pour s’y habituer. Il en découvrira rapidement la richesse parfois « tonitruante » par l’intelligence des propos: des jeunes qui disent le strict essentiel parce qu’ils savent qu’ils n’auront jamais le temps de parole médiatique qu’ils méritent. Au point que, plutôt que de parler pour ne rien dire, Kay interrompt l’entretien en disant « là je buggue ».
Quelle couleur donner à ce quartier du Gros Saule ? Une jeune femme répond : il serait rouge, solidarité et amour. Un autre, dans l’action d’une opération citoyenne de ramassage des déchets : « Si on peut pas sauver la planète on va sauver le quartier ».
C’est actif et c’est drôle tant la vitalité l’emporte. Kay, option musique : « Ex nihilo !… Ici c’est pas le Far-West non, c’est la Westcoast ». John tient un discours étonnant sur « l’argent facile », en s’étonnant de l’énergie qu’il avait mise, plus jeune, « dans le crime » où l’argent est difficile puisqu’on l’acquiert au risque de mourir. Contrairement aux idées reçues, l’argent facile est celui qu’on obtient en travaillant, dit-il. Un parfait éclairage de la lutte pour la vie. À propos de la drogue : « Tu peux déplacer une guêpe mais le nid sera toujours là ».
À côté de ça on détruit des tours. Éva Pénot les filme à les rendre belles sous la morsure des grues. Dans celles qui restent, l’ascenseur est en panne et le ménage n’est pas fait tandis qu’on paye 800 euros pour un F3 et des charges de régularisation d’eau de 500 euros. Rajae s’en étonne et paye quand même : « J’ai pas une piscine chez moi, j’ai un F3 ». Elle aimerait qu’on construise une médiathèque à la place des tours détruites.
Les propos sont immédiats et percutants. La réalisatrice filme des figures attachantes, qui ont un rapport non biaisé à la caméra ; ils font face sans la moindre provocation. Le rapport images/texte/musique se fait sur un bon rythme.
Fahrid, notre travailleur-social-plus, se réfère, côté littérature, à Salinger et Céline, « tout seul à traverser la nuit qui est le monde » ; côté cinéma à « Banlieue 13 » ou à Sergio Leone : « Si tu veux faire la révolution il faut mourir ». Et Steven interroge « le verbe, si c’est pas la meilleure force ». Même si pour Fahrid c’est « comme si tu écopais un bateau dont tu savais qu’il allait quand même couler ».
Ils ont conscience du désastre du lieu qui les enferme et n’en font pas un drame. Ils sont même d’une grande ouverture au monde. « Pour s’en sortir, faut sortir… Peut-être que ma casquette elle aurait été rose aujourd’hui, tu vois ce que je veux dire » dit Kay.
Enfin, à cinquante-six minutes, il y a un retour au calme, les quelques saules-pleureurs ont des feuilles et Kay, toujours lui, parle du miracle qu’il faudrait accomplir pour sortir de cette condition collective subie au quartier du Gros Saule : « Il faudrait qu’un musulman marche sur l’eau »…
Malgré l’ingratitude de la situation, malgré l’aridité et parfois la désolation des lieux filmés, le résultat est impressionnant. Et peut-être même, par cette difficulté surmontée, admirable.
Guy Lavigerie
Patience du regard, jouissance de l’image
« Sur le fil » de Chloé Jacquemoud (France, 2023))
À l’heure où commence le film sur la filature de Niaux dans l’Ariège, cela fait deux ans qu’elle est à l’arrêt ; pour cause d’accident grave de l’un de ses jeunes responsables, Loïc, qui portait un projet de reprise après la cessation d’activité du « patron » de l’entreprise, Jacques.
Qu’on se rassure, il ne s’agit pas ici du film promotionnel d’un quelconque modèle de capitalisme « new tech ». Chloé Jacquemoud commence par nous montrer des moutons et nous parler de souvenirs d’enfance à la campagne « avec des brins de laine » sur les fils barbelés et au fond de la poche. Nous retrouverons dans tout son récit cette constante approche sensible, jusque dans la manière de filmer.
Il s’agit donc d’un projet de reprise d’une filature, fondé de toute évidence sur une passion collective de tout un petit groupe de jeunes gens. On ne saura rien des motivations de chacun et c’est sans importance. On suivra plutôt le processus de longue et ardue reconstruction de cette utopie contrariée.
Dès la septième minute, on voit passer sur le visage de la compagne de travail de Loïc la souffrance du bras perdu de son compagnon. Ils sont pleins de courage. Chloé Jacquemoud ne nous présente aucun des personnages, aussi est-il difficile de les nommer individuellement. Il faudra se contenter de les découvrir dans l’action quotidienne et c’est très bien comme ça. Pas d’immixtion dans la vie privée. Ça ne fait pas moins d’humanité sous nos yeux.
Qu’est-ce qu’on voit ? Une filature à l’arrêt, dans un désordre apparemment inextricable. Le danger des installations désuètes est partout, mécanique, électrique… Et pourtant, progressivement, pas à pas, séquence après séquence, le travail avance secteur par secteur : lavage de la laine, nettoyage des énormes machines, remise en état des locaux…
La bande-son, faite parfois de musique à la guitare sèche et de bruits mêlés d’une mécanique rythmée, joue un rôle important quand il s’agit de prendre la mesure de l’avancée du projet décrite par une succession de séquences brèves sur les travaux en cours. Comme un sous-titre au film, les jeunes femmes nomment « le projet sans fin » qui est le leur. Elles en rient parce qu’à la 54è minute du film la filature est toujours à l’arrêt. La réalisatrice en off : « cette persévérance me questionnait ».
Les images sont très belles, en particulier par le fait qu’elles placent le spectateur en situation patiente de poser son regard sur des comportements, des attitudes, des gestes concentrés que rien ne prédestinait à la caméra.
Le sujet et les enjeux du film rappellent immanquablement cette autre réalisation sur une question du même ordre, « Les Agronautes » d’Honorine Perino, en 2017.
Guy Lavigerie