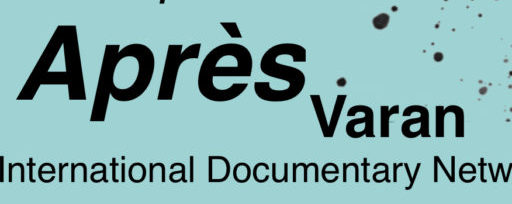Bienvenue au Festival International du Film Documentaire AprèsVaran!
Je vous propose, si vous voulez bien, pour aborder cette 7è édition, de faire un pas de côté vers ce qu’on appelle les arts vivants.
Voyons ce que nous pouvons en tirer :
Dans son dernier spectacle « Mère » qui relève du documentaire au théâtre, le metteur en scène Wajdi Mouawad nous présente un formidable exercice de narration censé reposer sur la mémoire personnelle qui – comme chacun sait – a « toujours » raison mais ne fait en réalité qu’inventer du récit. Il nous révèle comment une reproduction d’un tableau de Cézanne dans un petit meublé parisien où il a vécu en exil avec sa mère et ses frère et soeur tandis que son père vivait sous les bombes, lui a servi de cadre pour échapper au destin tragique de l’enfermement familial dans la guerre du Liban. Avant d’être expulsé de France et accueilli comme réfugié au Canada.
L’appartement du 15è arrondissement donnait sur le métro aérien tandis que le Cézanne accroché au mur (l’unique tableau de cet appartement) ouvrait l’imaginaire vital de l’enfant libanais qui n’avait pas même l’idée que la peinture soit un art et qu’elle a une fonction.
Pour nous aussi le film documentaire est un art et il a pour fonction de donner un cadre à des récits qui nous font échapper aux matraquages par lesquels nous sommes tous et toutes uniformément parlés comme dirait l’écrivain Lydie Salvayre. Uniformément parlés mais terriblement désunis de nous-mêmes et des autres.
Je forme le voeu que ce 7è festival AprèsVaran, contraint à la programmation en ligne en cette 5è vague de Covid, construise entre nous le récit qui nous manque!
Guy LAVIGERIE
réalisateur, metteur en scène
Respire, Souris, Vis, de Yen Le Van
L’entrée en matière se fait par un survol astronautique de la terre, suivi de la terre vue du ciel, d’un village zen en Périgord, d’une incursion à Londres, d’images d’archives de la Guerre du Vietnam sur lesquelles on entend « mes lèvres blanches sur tes belles lèvres noires ». Elle procède d’un tissage d’approches ponctuelles qui ne visent pas à l’explicitation mais à la contextualisation. A Londres, la question est posée à Laurent, un financier qui travaille chez lui, de dire pourquoi il médite. A Rome, c’est une conférence de « mindfullness » où il est question de conscience émergente. C’est aux Pays-Bas l’école de Leusden où la réalisatrice filme une séance avec de jeunes enfants qui se plongent en souplesse dans la conscience de soi dans le moment présent.
Vient la question centrale : l’histoire se répète ; sommes-nous capables d’en écrire une autre ? En faveur de la paix ? La Paix ? Et quel lien peut-il bien y avoir entre la méditation individuelle et la paix universelle ? La figure de Thich Nhât Hanh est, dans le film, le sujet conducteur du thème de la méditation – méditation en pleine conscience comme on dit désormais pour la distinguer du religieux. Car Thich Nhât Hanh, né en 1926 au Vietnam, devenu moine boudhiste, a connu la fameuse guerre du même nom.
On le revoit aux côtés de Martin Luther King. Exilé en France, il a fondé en Dordogne le village des Pruniers qui accueille de très nombreux pratiquants de la méditation en pleine conscience.
Les images tournées par Yen Le Van au village des Pruniers montrent une séance de yoga en salle aussi bien qu’un groupe de marcheurs « conscients » en pleine nature. La particularité du film est de croiser, au point de les tisser, des séquences socio-historiques et politiques des années 1970, en Suède, aux Etats-Unis avec le Student Action Coordinating Commitee (SACC) ou avec Daniel Ellsberg qu’on qualifierait aujourd’hui de « lanceur d’alerte », lui qui fut à l’origine des « Pentagon papers ». Soit une manière de situer le développement de la méditation en pleine conscience dans un large cadre politique.
De retour à soi avec Thich Nhât Hanh, c’est le « mal-être » qui est nommé comme noble vérité. On revient à Laurent le financier, qui n’a pas encore répondu à la question de savoir pourquoi il médite. Consciente de la difficulté, la réalisatrice, en off, interroge le phénomène de la « pleine conscience » : est-ce une mode ou un mouvement de fond ? Et peut-on concilier les affaires, la finance et l’éthique de vie ? Pas de réponse à cela. D’autant, on s’en rend compte, que la population qui tend vers cette pratique n’est pas issue de ce qu’on appelle les milieux populaires. « Est-on dans la dictature du bien-être? » s’interroge-t- elle encore ; « peut-être, peut-être pas. » Mais il est possible d’affirmer, comme le fait cette autre femme qui enseigne le yoga et dont la beauté tient à sa sérénité autant qu’à ses traits, que « c’est le souffle qui porte l’homme ».
Voici maintenant une nouvelle contextualisation avec le pôle neurosciences de l’Université de Strasbourg dont la recherche vise un fonctionnement unifié de l’esprit et du corps. Les étudiants pratiquent, entre autres, la marche consciente. Le film opère un recoupement avec le village des Pruniers où Thich Nhât Hanh, calme et empathique, invite une assemblée d’invidus à « voir les pensées être juste des pensées ». Plan par plan, une touche après l’autre. Quand soudain les images des enfants de l’école de Leusden aux Pays-Bas sont comme une plage de lumière sur de vivants visages paisibles concentrés, qui jouent à être « aussi tranquilles qu’une souris »… ou la méditation avec Grégoire la grenouille. Et ce sont probablement les plus belles images de ce film, les plus étonnantes.
Ecrit comme à l’intention des croyants et des incroyants de la « pleine conscience », le film n’est pas une narration, ne fait pas narration. Il expose à distance.
Renés, de Daphné Mongibeaux
Une modeste maison au bord d’une voie ferrée. Un vieux couple qui s’aime, Marie-Jo et René. Lui fait son jardin et bricole. Elle puise son amour dans une foi religieuse et supersticieuse. Le film nous fait entrer chez eux et pourtant nous ne pouvons affirmer qu’il nous mette en lien avec eux. Il ne repose pas sur la narration mais sur des images dont certaines sont d’une beauté insolite. Nous sommes plus proches de ces images que de ce qu’elles nous disent de Marie-Jo et de René.
Je reste un peu sur ma faim, pas très convaincu par la rencontre mais séduit parfois par la focalisation sur des objets de l’intime cadrés comme en peinture.
Une place au soleil, de Clara Beaudoux
Un film tout en figures et en motifs extérieurs réalisés depuis une situation de confinement dans un appartement en Belgique. Car on devine sans difficulté qu’on n’est pas en France. Il y a une multiplicité d’images très belles, fenêtres, façades, figures humaines sur place publique (parfois accélérées sur le mode du « muet ») dans un jeu permanent d’alternance. Le plus souvent par grand soleil, d’où le titre à prendre au pied de la lettre (une place – publique – au soleil) et au figuré (chacun sa place au soleil). Comme il se doit, la continuité filmique est assurée par le son, principalement tiré des appareils radiophoniques ou télévisés domestiques qui donnent les informations quotidiennes sur l’épidémie de Covid. Vient le moment où le son radiophonique est remplacé par celui d’une conversation téléphonique avec une vieille dame qui met en doute l’idée de réaliser un film sur le confinement, trouvant le projet « étriqué », et délivre des conseils à la réalisatrice ; c’est un moment léger par son incongruité sans conséquence. Mais tout dans le film est beau et léger à la fois. Par exemple la vue de ce camion de nettoyage qui dessine un immense coeur avec de l’eau, parce que la place est déjà propre, donne parfaitement le contexte du confinement où la population invente des signes de reconnaissance dans l’adversité. Cependant ce film n’a rien d’erratique, au contraire, il est parfaitement composé à partir de tout le matériau réuni. Un film unique qui révèle l’invisible communauté d’une situation extraordinaire de la vie ordinaire.
Qui est là? de Souad Kettani
Une seule image du Maghreb, plan fixe en ouverture
du film, et l’on entend longuement comme le marteau d’un artisan. La suite se passe en France, dans un quartier de Villeneuve-La-Garenne. Le dispositif est simple et classique. Il repose sur le talent relationnel de la réalisatrice et de son équipe avec les personnes filmées. Nous sommes dans une salle de classe, d’abord dans un cours de philo où l’on pose la question du rapport entre la matière et l’esprit. Puis c’est un lycéen qui parle d’Aïcha, cet « esprit » qui hante la ville de Beni Mellal au Maroc : « Je ne l’ai jamais vue mais on en parle toujours ». Crainte de devenir fou,
de perdre la raison. S’en défendre en allumant les lumières le soir. La réalisatrice obtient des lycéens et lycéennes qu’elle interroge individuellement des réponses authentiques et belles. On accède ainsi à une vérité psycho-culturelle inédite dans le champ social rationnel. L’alternance des portraits réalisés en entretien avec les
images extérieures (parfaitement choisies et cadrées) de la cité qui entoure le lycée est très équilibrée. Les rares musiques utilisées arrivent à point nommé. On assiste à un moment de jeu entre amis (garçons et filles) pour exorciser la question en riant: « tu l’as déjà vu, Dieu ? » aussi bien qu’à la prononciation en arabe, par un lycéen en confiance, de trois sourates qui protègent… Mais encore à ce moment très fort où une jeune femme marche avec précaution dans la friche entre les immeubles qu’elle dit chargée de « morts », qu’elle ressent physiquement parce qu’elle a mal quand elle s’en approche. Le film de Souad KETTANI est une simple et belle réussite.
DANIEL Douala-Montpellier, de Maria Van munster
Raconter depuis Montpellier, la ville et son environnement, par des rails, un train, ses essieux… plus loin par les plages et la mer, les dunes, les barrières dans les dunes… par tous ces éléments de récit parcourus par des travellings parfaitement respirés… Raconter sans pathos le périple de Daniel parti de Douala, « échoué » au bout de trois ans à Montpellier avec sur le dos une obligation de quitter le territoire… Raconter avec des images forgées ici les épreuves endurées à Ceuta, avec la voix de Daniel, ses mots. De loin en loin ses mots comme épinglés, gravés dans du bois, peints sur un rocher, qui disent telles des pancartes brechtiennes entre deux séquences « je ne savais pas ce qui m’attendait » ou « ça m’a pris des mois »… Maîtriser le récit métonymique par l’image vivante sans se substituer à Daniel mais en l’accompagnant et en faisant de lui un sujet autonome dont nul ne peut partager la souffrance, c’est ce que réussit admirablement Maria Van Munster.

Sur Linkedin :
Twitter :