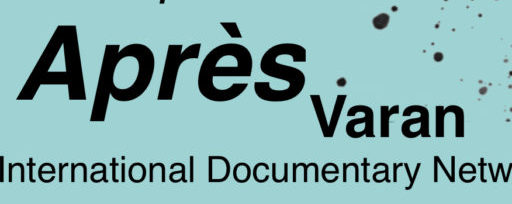Entretien de Mina Rad avec Eric Galmard
Question : Comment l’idée du film vous est-elle venue ?
Eric Galmard : C’est en 2002, il y a donc bien longtemps, que j’ai « rencontré » pour la première fois Khun Srun grâce au travail de traduction d’un ami écrivain, Christophe Macquet. Il devait présenter dans la revue Europe un panorama de textes cambodgiens modernes et avait inclus plusieurs extraits d’œuvres de Khun Srun dans sa sélection. C’est un extrait traduit d’Un homme en examen, son dernier livre, qui m’a frappé d’emblée. L’écrivain y évoque son incarcération au début des années 1970 dans une prison du régime anti-communiste de Lon Nol.
« Je sais qu’il est dangereux de vivre parmi les hommes. Je le sais depuis plus de vingt ans, depuis que j’ai l’âge de raison. Mais en vingt ans, pourtant, je n’ai jamais eu peur comme aujourd’hui. Jamais. Là maintenant, je suis complètement seul, sans échappatoire. […] Il me reste tout de même un espoir. Minuscule. Je sais que je suis innocent et qu’on m’accuse à tort. Alors j’essaie de me donner le change, j’essaie d’être optimiste : l’inspecteur est un Khmer, il a la peau sombre et le même sang que moi. ».
Bien sûr, c’est la dernière phrase que j’ai retenue de par son ironie tragique : l’humaniste qu’était Khun Srun voulait croire, malgré ses doutes, malgré tout, à la possibilité d’une compréhension commune, ou en tout cas d’une reconnaissance de l’autre qui exclue le recours à la violence ultime. Ironie tragique car j’ai appris en même temps ce qu’avait été le destin de cet écrivain : il a été broyé par la machine de mort de ceux à qui il s’était tardivement rallié en 1973 en entrant dans le maquis : les Khmers rouges. Il a été victime de la dernière purge du régime : il a été arrêté et conduit à S21 le 20 décembre 1978, très peu de temps avant l’arrivée des troupes vietnamiennes à Phnom Penh.
En découvrant ensuite d’autres textes de Khun Srun, il m’a semblé qu’il avait « quelque chose », une sincérité, un ton, un style bien à lui, unique. Bien sûr, il a arrêté d’écrire très jeune, à vingt huit ans, quand il est entré dans le maquis et en un sens, ses textes sont une promesse. Mais en peu de temps, il a exploré différents chemins littéraires : nouvelles fictionnelles, textes autobiographiques, anecdotes philosophiques, poésie satirique. Ce qui est touchant chez lui, c’est cette manière qu’il a, assez unique dans la littérature khmère, de s’interroger sur lui-même, d’exposer ses doutes, de se mettre en examen pour reprendre le titre de son dernier livre « Un homme en examen ». Il y a dans ses textes une influence forte de l’existentialisme français, à la fois de Camus et de Sartre et en même temps on y trouve une tension très forte entre d’une part ce questionnement intellectuel et d’autre part un attachement sentimental pour la tradition khmère et le monde rural cambodgien dont il est issu.
Il y a aussi autre chose qui m’a frappé et qui m’a poussé à faire le film : il porte un regard critique aigu sur la société de son époque en mettant l’accent sur la corruption, la spéculation foncière, l’écrasement matériel et moral des petits ou encore ce qu’il appelle « les vices cachés du développement ». Or, ce regard critique m’est apparu encore largement pertinent pour le Cambodge d’aujourd’hui. Tout a changé et rien n’a changé, semblait-il me murmurer. Cela valait donc encore plus la peine de faire entendre sa voix puisqu’elle parlait du présent.
Je dois ajouter à ce propos quelque chose de personnel : en 2002, quand j’ai découvert ses textes, j’avais déjà quitté le Cambodge où j’avais enseigné dans les années 90 et il me semblait que cette découverte venait combler une forme de vide artistique et intellectuel que j’avais ressenti quand j’y avais vécu. Mon séjour avait été riche de rencontres humaines passionnantes, d’autant plus que les Cambodgiens étaient à l’époque avides de contacts avec des étrangers, après plus de quinze ans d’isolement très fort du pays. Mais il m’était difficile d’avoir accès à des oeuvres artistiques qui témoignent d’un regard critique cambodgien (en dehors du travail de Rithy Panh bien sûr), et cette découverte a été une forme de révélation : voilà un écrivain, et au delà de lui voilà une génération d’écrivains, nés autour de 1945, qui avaient profité après la décolonisation de la possibilité qui leur avait été donnée de suivre des études longues, et qui en même temps avaient aussi exploité la fenêtre sur le monde qu’offrait la langue française. Ce qui en avait résulté, c’était un âge d’or de la littérature cambodgienne aux confins des années 60 et 70, et une génération d’écrivains, d’intellectuels talentueux, dotés d’un véritable regard personnel et critique. On connait la suite : cette génération a été fauchée par l’Histoire. La plupart ont été assassinés par les Khmers rouges, les autres se sont exilés.
Je crois que cette génération d’intellectuels critiques manque cruellement au Cambodge contemporain, et ce film est en ce sens destiné aux jeunes Cambodgiens d’aujourd’hui : Khun Srun, comme presque tous les autres de cette génération, sont à peu près complètement oubliés aujourd’hui au Cambodge. Il faut donc essayer de faire entendre sa voix d’écrivain critique.
Question : On ressent à la vision du film une forte intimité entre vous et les personnes filmées. Comment avez-vous approché ces personnes présentes dans le film ?
Eric Galmard : Bien sûr, il ne s’agissait pas de faire un reportage en mettant d’emblée une caméra sous le nez des différents témoins. J’ai pris mon temps pour les répérages et les rencontres, d’autant plus qu’initialement, du fait de mon activité professionnelle, je n’avais pas le temps matériel pour entreprendre la réalisation d’un film produit professionnellement ! C’est seulement quand j’ai commencé à enseigner le cinéma à l’université (de Strasbourg) que j’ai pu entreprendre le film et ensuite cela m’a pris presque cinq ans au total entre 2010 et 2015 pour l’achever.
Par ailleurs, je crois que presque tous les témoins présents dans le film, les gens de la famille et les autres, avaient à l’esprit lors du tournage, que le film était un film pour Khun Srun, que c’était un film-hommage. Et dès lors, ils avaient envie d’être là, cela avait du sens pour eux. Cela doit se ressentir dans le film.
J’avais en fait aussi filmé des séquences plus didactiques avec quelques intellectuels-experts qui éclairaient le contexte, fournissaient des points de vue surplombants sur l’Histoire. Mais avec Christine Benoit, la monteuse avec qui j’ai travaillé, nous avons rapidement décidé de les écarter pour nous concentrer dans le récit sur les deux figures principales, la voix fantôme de l’écrivain et sa fillle survivante Khem. Je pensais, nous pensions que cette voix était assez forte, en termes à la fois intellectuels et émotionnels, pour tenir par elle-même, dans la mesure aussi où elle était en quelque sorte relayée dans le présent par le destin de sa fille. Et à partir de là, nous nous disions également que le spectateur n’avait pas besoin à chaque seconde du film de se voir expliquer le récit, qu’il pouvait « travailler » par lui-même par rapport aux deux questions principales du récit : d’une part la question de l’engagement – pourquoi un humaniste comme Khun Srun a-t-il fait le choix, même tardif, de s’engager dans le maquis révolutionnaire, du côté des Khmers rouges ? -, et d’autre part la question du rapport au présent de cette voix d’écrivain – ce que cette voix a à dire sur le monde d’ajourd’hui, avec la « fonction » d’écho terrible de la situation présente de sa fille.
Mais pour revenir aux relations avec les personnes filmées, tout n’a pas été facile, loin de là au moment du tournage, ou plutôt des tournages car il y en a eu deux, à deux ans et demi d’intervalle. Avec Khem justement, c’était compliqué : la présence de la caméra semblait, contrairement aux autres, la paralyser et elle avait beaucoup de mal à se concentrer. Elle était là, sans vraiment être là. D’un côté, elle était très fière de participer à ce film en hommage à son père et elle avait envie d’en savoir plus sur lui. Mais de l’autre, je crois qu’elle avait en tête d’autres choses, à commencer par ses soucis matériels. Bref, elle n »y arrivait pas vraiment.
Cela m’a amené à la faire jouer : elle est devenue actrice d’elle-même. A partir bien sûr de sa propre parole, j’ai été amené à la faire répéter, à la diriger et à faire plusieurs prises, comme si c’était de la fiction. Dès le départ, je n’avais bien sûr pas imaginé de faire strictement du direct, puisqu’il s’agissait d’un film dont la figure principale est une voix fantôme qui vient du passé. Mais je n’avais pas forcément envisagé d’aller aussi loin du côté d’une mise en scène fictionnelle. Avec Khem, ce qui s’est produit le plus souvent, c’est qu’au bout d’une série de prises, avec la répétition et la fatigue, elle se laissait aller,et apparaissait alors vraiment présente, « incarnée » si je puis dire. L’avant-dernière séquence du film lorsque, allongée sur son lit la nuit, elle se confie, fait exception. C’est presque la dernière séquence que nous avons filmée, et là, quelque chose s’est produit : je lui avais demandé de dormir et elle s’était vraiment endormie ! Quand elle s’est réveillée, en pleine nuit, elle s’est confiée comme jamais elle ne l’avait fait. C’était bien sûr un moment très important, un trésor intime qu’elle nous a confié à ce moment-là.
Question : Le film apparaît fortement mise en scène. Pouvez-vous évoquer ce travail que vous avez effectué ?
Eric Galmard : je l’ai dit plus haut, j’ai été amené à faire « jouer » Khem, et cela m’a amené avec mon chef opérateur cambodgien Bun Chanvisal à composer des cadres et à découper les séquences davantage à la manière d’une fiction. Ce faisant, j’ai aussi inscrit dans cette mise en scène mon point de vue sur les personnes filmées et leurs relations : j’ai joué par exemple classiquement sur la co-présence ou au contraire sur la séparation des personnages dans le cadre. Khem n’est pas filmée de la même manière dans la séquence nocturne avec ses enfants, où nous avons utilisé un plan-séquence qui relie les trois personnages et dans la séquence avec sa cousine, devant le tombeau de la grand-mère, où à la fois la composition du cadre et des champs-contrechamps séparent les deux personnages.
Par ailleurs, j’ai essayé de jouer avec les espaces et leurs récurrences dans le récit qui leur confèrent une résonnance symbolique. C’est le cas de la voie ferrée qui sépare l’ancien atelier où a travaillé Khun Srun et où il a été arrêté et les squats où habitent des gens expropriés, et aussi de manière plus minimale du gratte-ciel dont la forme, presque monstrueuse, apparaît au loin dans le même plan. Ou encore au début du film, lorsque dans une séquence un ancien ouvrier évoque devant Khem ce rêve de Khun Srun à l’époque khmère rouge de vivre paisiblement en famille dans une petite maison, ce sont les squats du présent qui apparaissent à l’arrière plan et annoncent subrepticement la question sociale d’aujourd’hui qui revient plus tard dans le film à travers notamment le témoignage de deux squatters, pratiquement au même endroit. Il y a aussi ces cadeaux que nous donne le réel et dont il faut profiter : dans le même registre que le dernier exemple ci-dessus, il y a cette banderole en français « Phnom Penh charmante ville » qui apparaît à l’arrière plan derrière Khem au début du film ou encore sur le plan sonore les grognements des cochons promis à l’abattoir qui se font entendre lorsque Nop, le petit fils de Khun Srun, évoque les manoeuvres illégales des anciens chefs khmers rouges pour s’enrichir sur le dos des pauvres.
Enfin, la question de mise en scène peut-être la plus importante était celle de la place de la voix-fantôme de l’écrivain dans le film : comment créer un espace cinématographique le plus juste possible pour faire résonner cette voix non seulement dans le passé mais aussi et surtout au fil du film de plus en plus dans le présent, en particulier après la séquence avec le frère cadet de Khun Srun (qui casse le film en deux et l’oriente définitivement vers le présent) ? Pas de principe théorique a priori bien sûr, mais des essais et encore des essais à la fois avec des archives et des images du présent en jouant rhétoriquement et émotionnellement sur la mise en relation verticale des paroles, celles de la voix-fantôme, avec le sonore et le visuel. Certains choix étaient arrêtés avant le début du tournage : l’ouverture et la clôture du récit par exemple. Je savais que je voulais avoir au début des images des celllules de S21 avec les paroles irnoniquement auto-prophétiques de Khun Srun (voir la citation plus haut), et à la fin il y avait l’idée d’une cérémonie filmique mise en scène en relation avec le poème utilisé. Mais à d’autres endroits du récit, nous avons tâtonné.
Question : Pouvez-vous nous dire en quoi Jean Rouch a pu être une source d’inspiration importante pour ce film ?
Eric Galmard : Rouch tient pour moi une place à part dans l’histoire du cinéma documentaire. Il est sans doute le premier, avant l’apparition des caméras légères couplées à des magnétophones, à avoir cherché dans sa démarche même de mise en scène documentaire à donner la parole à l’autre, à celui qui était jusqu’alors invisible ou muet. C’est notamment ce film extraordinaire qu’est Moi un noir. Tout est bien sûr dans le titre : pas seulement un film empathique vis-à-vis des colonisés, mais un film où se donne merveilleusement à entendre une voix subjective, avec ses frustrations et aussi ses parts d’ombre. C’est d’abord cette référence que j’avais en tête : beaucoup de films documentaires ont été faits autour de la Catastrophe khmère rouge et assez souvent, on y retrouve des points de vue d’experts ou de journalistes étrangers. Je voulais donner à entendre de l’intérieur la voix, le point de vue singulier, unique d’un cambodgien de l’époque, à la fois un intellectuel moderniste et un homme de la campagne attaché sentimentalement à une certaine tradition, et je voulais aussi ne pas m’en tenir au passé et faire le lien avec le présent à travers la question sociale.
Pour en revenir à Jean Rouch et à ce film essentiel qu’est Moi un noir, il y a autre chose dans le titre, ce désir rouchien, partagé avec les autres participants au film, de devenir autre – ou de jouer à devenir autre – de se réinventer, de « bricoler » de façon impure son identité, de manière plus ou moins provisoire, par notamment l’acte de création du film. Je ne saurais du tout prétendre à quelque chose de ce genre, mais il n’y pas non plus véritablement de hasard. Ce film se veut un exercice d’admiration, un hommage, un tombeau filmique et si cette voix a résonné en moi, c’est sans doute pour « quelque chose ».
Pour conclure, je voudrais citer la fin de la préface que Christophe Macquet consacre à l’Accusé, le dernier livre de Khun Srun (à paraître, Éditions du Sonneur, printemps 2018) et dans laquelle il cite lui-même l’écrivain :
« J’ai un espoir (je joins les mains et je prie en secret). C’est une idée que l’on trouve chez Koy Sarun, dans son recueil de poèmes, Puisque nous sommes humains.
Il y a une place, loin de la course aux honneurs et aux richesses. Une place pour autre chose. Une place pour étudier. Une place pour méditer.
Il y a une voix. Dans le concert assourdissant des puissants. Une voix que personne ou presque n’écoute.
C’est la voix du poète (de l’écrivain minuscule, négligeable, méprisable, du « pou », comme dit Keng Vannsak). (…)
J’ai un espoir. Que cette voix, si faible soit-elle, ne meure pas. »
Nous partageons cet espoir, ajoute Christophe pour finir. Au risque peut-être de paraître « gentiment » humaniste, je voudrais m’ajouter à ce nous.
UN TOMBEAU POUR KHUN SRUN
67 min, 2015, France
Production : Dora Films
Sélectionné : Cambodia International Film Festival, Cambodge, décembre 2015
Festival Film Dokumenter, Indonésie, décembre 2015
Festival Itinérances, Alès, France, mars 2016
Festival International du Film Francophone, Namur, Belgique, octobre 2016
Festival du Film de Fontenay-le-Comte, France, mars 2017
Label Images en bibliothèques, BPI, catalogue national des films documentaires pour les bibliothèques publiques, octobre 2016
Avec le soutien de : Scam, brouillon d’un rêve
Synopsis : Khun Srun, écrivain cambodgien, un des plus brillants de sa génération.
En 1973, il entre dans le maquis révolutionnaire et est finalement exécuté par le régime khmer rouge en décembre 1978.
Ce film veut faire entendre sa voix d’écrivain, autobiographique et critique, sincère et satirique. Si elle nous interroge sur l’itinéraire d’un intellectuel qui a choisi pour son malheur le camp révolutionnaire, cette voix ne résonne pas seulement dans le passé, mais aussi dans le présent qu’elle est capable de questionner directement
Il ne s’agit donc pas uniquement de rendre compte de la vie et de l’œuvre passées de cet écrivain. C’est bien le présent que vise le film : il est notamment incarné par la fille de l’écrivain, Khun Khem qui se confronte à la mémoire de son père. Seule survivante de la famille, elle vit aujourd’hui dans des conditions matérielles précaires à Païlin, ancien fief khmer rouge.
Après avoir étudié la littérature et le cinéma, Eric Galmard a travaillé dans plusieurs pays asiatiques (Philippines, Japon, Cambodge), et dans le Pacifique (îles Fidji), à la fois en université et dans le réseau culturel français. Depuis 2009, il enseigne le cinéma au sein de la faculté des arts de l’université de Strasbourg, s’intéressant en particulier au cinéma documentaire et aux cinémas d’Asie. Un tombeau pour Khun Srun est son premier long métrage.
Montage : Christine Benoit
Image : Bun Chanvisal
Son : Jean-Baptiste Haehl Sear Visal