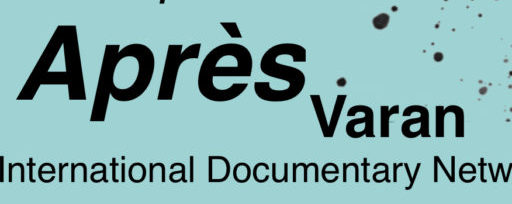Guy LAVIGERIE : Comédien et metteur en scène, il a aussi porté avec succès les oeuvres littéraires et théâtrales en milieu rural – souvent avec des habitants acteurs et actrices remarquables – grâce à J’Irai marcher sur les Toits: https://jirai.fr
Il s’est formé à Varan en 2003, à la suite d’un projet inachevé avec le journaliste et réalisateur chilien José Maldawski. Après sa formation, il a réalisé quelques films dont deux ont été programmés dans le Festival Après-Varan, en 2015 et en 2019. Dès 2015, il a reconnu tout l’intérêt de la démarche de Mina Rad, porteuse d’une utopie raisonnable, celle de rassembler les réalisateurs et réalisatrices « après-varan » qui le veulent bien. Il défend l’idée d’un réseau solidaire. Pour lui, la force d’Après-Varan est dans sa capacité d’exister à long terme par le renouvellement de ses membres issus des formations. C’est aussi d’accéder à une compréhension collective dégagée des compétitions d’intérêts particuliers. Une démarche profitable à chacun et chacune, en somme.
Guy LAVIGERIE est membre Après varan depuis 2015 et il est membre du comité de l’organisation du Festival International du film documentaire Après-Varan 2023.
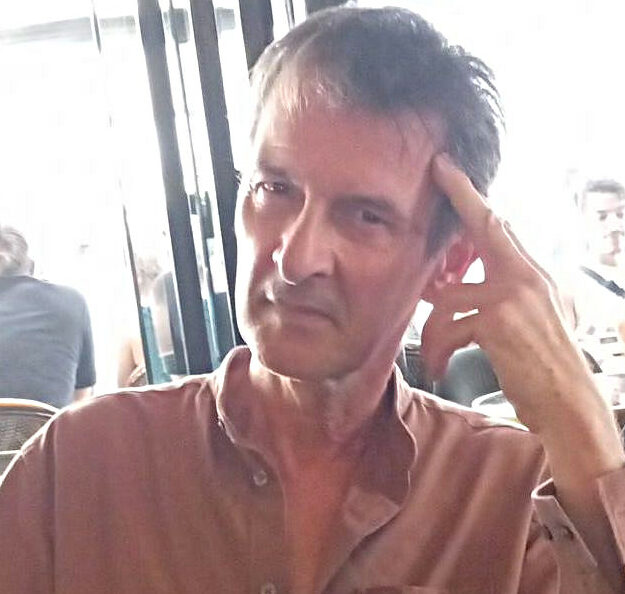
« Annie-Paule THOREL » de Guy Lavigerie – Festival 2019
Projection Mercredi 11 septembre à 21h15
A la SACD 11 bis, rue Ballu, 75009 Paris
« Annie-Paule THOREL » de Guy Lavigerie (21’, 2007, France)
En présence d’Anne-Paule Thorel et Guy Lavigérie

Toujours le spectateur voudra qu’on lui dise ce qu’il va voir. Cela vaut pour ce film sur la peintre Annie-Paule Thorel en situation de création, dont je me contentais jusqu’alors de poser dans le synopsis le cadre social externe, tant il me semblait que par contraste on percevrait le temps long de la patience du geste et le soin de toute une équipe porté à l’oeuvre en cours. Or loin de croire que le spectateur accèdera d’emblée à une manière de faire, je dois expliciter à quoi il peut s’attendre à l’approche des images.
A la fin du siècle dernier, Annie-Paule et moi nous sommes formés ensemble à l’art-thérapie, qui est une façon toute particulière de porter attention à l’humain. On y est tenu d’opérer un certain « vide » si on veut laisser la place à l’expression centrale de l’autre en vis-à-vis. Inutile de préciser combien dans notre société du plein égotisme cette démarche est une étrangeté, y compris dans le domaine de la création artistique.
Pourquoi le réalisateur s’efface-t-il au point qu’on ne sache pas ce qu’il veut vouloir dire ? s’inquiètera celui qui a peur du silence. Réponse : le réalisateur s’efface parce qu’il a besoin que l’artiste et son équipe l’oublient afin de mieux capter leur présence au travail.
Avant de filmer, j’ai rencontré plusieurs fois Annie-Paule dans son atelier en Bourgogne. J’ai autant aimé l’émotion concrète immédiate que produit sa peinture souvent chaude comme la pierre qui apaise, que le lien qu’on la voit entretenir avec elle comme avec la matière en ses mouvements secrets. J’ai reconnu ses œuvres et les ai accueillies comme autant d’espaces de respiration ; grâce aux textures et aux couleurs mêlées comme par un marouflage peaufiné à main nue.
Par mon silence je pointe l’acuité du regard et le soin de la peintre pour sa toile, où support, matière et représentation ne font qu’un. Il appartient à chacun de s’autoriser d’en faire l’approche sensible. Et pour cela de s’ouvrir au dialogue intime avec lui-même dans le temps réel du regard qu’il ose porter à l’autre. En fait j’ai filmé un processus de réalisation d’une œuvre en portant particulièrement attention à ce qui retenait celle de l’artiste.
Tous mes remerciements à Mina Rad qui héberge ce film.
Guy Lavigerie

Synopsis
En banlieue dijonnaise, une installation plastique dans un environnement culturel apparemment appauvri, en réponse à une commande institutionnelle: où l’on voit l’artiste-peintre Annie-Paule Thorel et son équipe en pleine réalisation d’une oeuvre exigeante accessible à tous.

Bio
Formé à la réalisation en 2003 aux Ateliers Varan, Guy Lavigerie est principalement metteur en scène et comédien.
Il accomplit un travail territorial de création pour permettre au public d’être partie prenante d’œuvres scéniques et textuelles exigeantes. Avec J’Irai marcher sur les Toits, une structure artistique qui vise à créer de la valeur sociale en milieu rural deux-sévrien (Poitou), il conduit de nombreux projets artistiques citoyens.
Et si vous souhaitez voir le film :
Les « petits mots » du comité sur le film
Une beauté esthétique, une approche originale.
Débat animé par Mina Rad
Le regard de Guy Lavigerie sur la 7è édition du Festival :
Bienvenue au Festival International du Film Documentaire AprèsVaran!
Je vous propose, si vous voulez bien, pour aborder cette 7è édition, de faire un pas de côté vers ce qu’on appelle les arts vivants.
Voyons ce que nous pouvons en tirer :
Dans son dernier spectacle « Mère » qui relève du documentaire au théâtre, le metteur en scène Wajdi Mouawad nous présente un formidable exercice de narration censé reposer sur la mémoire personnelle qui – comme chacun sait – a « toujours » raison mais ne fait en réalité qu’inventer du récit. Il nous révèle comment une reproduction d’un tableau de Cézanne dans un petit meublé parisien où il a vécu en exil avec sa mère et ses frère et soeur tandis que son père vivait sous les bombes, lui a servi de cadre pour échapper au destin tragique de l’enfermement familial dans la guerre du Liban. Avant d’être expulsé de France et accueilli comme réfugié au Canada.
L’appartement du 15è arrondissement donnait sur le métro aérien tandis que le Cézanne accroché au mur (l’unique tableau de cet appartement) ouvrait l’imaginaire vital de l’enfant libanais qui n’avait pas même l’idée que la peinture soit un art et qu’elle a une fonction.
Pour nous aussi le film documentaire est un art et il a pour fonction de donner un cadre à des récits qui nous font échapper aux matraquages par lesquels nous sommes tous et toutes uniformément parlés comme dirait l’écrivain Lydie Salvayre. Uniformément parlés mais terriblement désunis de nous-mêmes et des autres.
Je forme le voeu que ce 7è festival AprèsVaran, contraint à la programmation en ligne en cette 5è vague de Covid, construise entre nous le récit qui nous manque!
Guy LAVIGERIE
réalisateur, metteur en scène

Les mots de Guy Lavigerie sur les films du Festival 2023:
Une maîtrise iconique de l’image et du récit
« 12 lessons » de Giorgi Mrevlshvili (Georgie, 2020)
On ne peut qu’être impressionné par la qualité du travail de Giorgi Mrevlishvili pour raconter le lien et la prise en charge d’un enfant autiste par son grand-père pourtant démuni, dans une campagne démunie.
Le tournage a lieu le plus souvent sous la pluie ou dans le froid dans un environnement désolé mais non désespéré, car le sens de la solidarité y a encore une part.
La force du détail suscite d’autant mieux l’attention du spectateur que l’oeil du réalisateur le sert comme sur un plateau au milieu d’un désert. Que ce soit à travers une vitre embuée d’une voiture ou un très gros plan sur un poing adulte serrant la main de l’enfant, il y a comme une maîtrise icônique de l’image dans la manière de filmer du réalisateur. Et une belle manière de resserrer les plans sur chaque thème exploré, tel l’apprentissage du parcours d’obstacles à bicyclette.
Les douze séquences du documentaire sont autant de mouvements filmiques qui assurent la réussite incontestable de 12 lessons.
Guy Lavigerie
An iconic mastery of image and narrative
One can only be impressed by the quality of Giorgi Mrevlishvili’s work to tell the story of the bond and the care of an autistic child by his helpless grandfather, in a destitute countryside.
Filming usually takes place in the rain or in the cold in a desolate but not desperate environment, because the sense of solidarity still has a part to play in it.
The strength of the detail arouses the viewer’s attention all the better as the director’s eye serves him as if on a set in the middle of a desert. Whether it’s through a fogged window of a car or a very close-up of an adult fist shaking the child’s hand, there is a kind of iconic mastery of the image in the director’s way of filming. And it’s a great way to tighten up the plans on each theme explored, such as learning the obstacle course on a bicycle.
The twelve sequences of the documentary are as many filmic movements that ensure the undeniable success of 12 lessons.
Guy Lavigerie
Comme une provocation au miracle social
« Ici on creuse » de Éva Pénot (France, 2023))
Ça commence bien, on est un peu surpris par l’abrupte lecture d’un texte sur un quai de RER mais on est dans le vif du sujet qui prend aussitôt le tour dynamique d’un défilé d’images industrielles bordant la voie entre la banlieue et Paris.
Puis on découvre en action le personnage central. Fahrid, bien plus que travailleur social, parle vite et net à ceux qui baissent les bras : « Moi je creuse et toi tu rebouches ! »
Éva Pénot a mis au point un dispositif rapproché de prises de parole brèves, face caméra, par plusieurs jeunes habitants du quartier. Le spectateur doit prendre le pouls de ces inserts pour s’y habituer. Il en découvrira rapidement la richesse parfois « tonitruante » par l’intelligence des propos: des jeunes qui disent le strict essentiel parce qu’ils savent qu’ils n’auront jamais le temps de parole médiatique qu’ils méritent. Au point que, plutôt que de parler pour ne rien dire, Kay interrompt l’entretien en disant « là je buggue ».
Quelle couleur donner à ce quartier du Gros Saule ? Une jeune femme répond : il serait rouge, solidarité et amour. Un autre, dans l’action d’une opération citoyenne de ramassage des déchets : « Si on peut pas sauver la planète on va sauver le quartier ».
C’est actif et c’est drôle tant la vitalité l’emporte. Kay, option musique : « Ex nihilo !… Ici c’est pas le Far-West non, c’est la Westcoast ». John tient un discours étonnant sur « l’argent facile », en s’étonnant de l’énergie qu’il avait mise, plus jeune, « dans le crime » où l’argent est difficile puisqu’on l’acquiert au risque de mourir. Contrairement aux idées reçues, l’argent facile est celui qu’on obtient en travaillant, dit-il. Un parfait éclairage de la lutte pour la vie. À propos de la drogue : « Tu peux déplacer une guêpe mais le nid sera toujours là ».
À côté de ça on détruit des tours. Éva Pénot les filme à les rendre belles sous la morsure des grues. Dans celles qui restent, l’ascenseur est en panne et le ménage n’est pas fait tandis qu’on paye 800 euros pour un F3 et des charges de régularisation d’eau de 500 euros. Rajae s’en étonne et paye quand même : « J’ai pas une piscine chez moi, j’ai un F3 ». Elle aimerait qu’on construise une médiathèque à la place des tours détruites.
Les propos sont immédiats et percutants. La réalisatrice filme des figures attachantes, qui ont un rapport non biaisé à la caméra ; ils font face sans la moindre provocation. Le rapport images/texte/musique se fait sur un bon rythme.
Fahrid, notre travailleur-social-plus, se réfère, côté littérature, à Salinger et Céline, « tout seul à traverser la nuit qui est le monde » ; côté cinéma à « Banlieue 13 » ou à Sergio Leone : « Si tu veux faire la révolution il faut mourir ». Et Steven interroge « le verbe, si c’est pas la meilleure force ». Même si pour Fahrid c’est « comme si tu écopais un bateau dont tu savais qu’il allait quand même couler ».
Ils ont conscience du désastre du lieu qui les enferme et n’en font pas un drame. Ils sont même d’une grande ouverture au monde. « Pour s’en sortir, faut sortir… Peut-être que ma casquette elle aurait été rose aujourd’hui, tu vois ce que je veux dire » dit Kay.
Enfin, à cinquante-six minutes, il y a un retour au calme, les quelques saules-pleureurs ont des feuilles et Kay, toujours lui, parle du miracle qu’il faudrait accomplir pour sortir de cette condition collective subie au quartier du Gros Saule : « Il faudrait qu’un musulman marche sur l’eau »…
Malgré l’ingratitude de la situation, malgré l’aridité et parfois la désolation des lieux filmés, le résultat est impressionnant. Et peut-être même, par cette difficulté surmontée, admirable.
Guy Lavigerie
Patience du regard, jouissance de l’image
« Sur le fil » de Chloé Jacquemoud (France, 2023))
À l’heure où commence le film sur la filature de Niaux dans l’Ariège, cela fait deux ans qu’elle est à l’arrêt ; pour cause d’accident grave de l’un de ses jeunes responsables, Loïc, qui portait un projet de reprise après la cessation d’activité du « patron » de l’entreprise, Jacques.
Qu’on se rassure, il ne s’agit pas ici du film promotionnel d’un quelconque modèle de capitalisme « new tech ». Chloé Jacquemoud commence par nous montrer des moutons et nous parler de souvenirs d’enfance à la campagne « avec des brins de laine » sur les fils barbelés et au fond de la poche. Nous retrouverons dans tout son récit cette constante approche sensible, jusque dans la manière de filmer.
Il s’agit donc d’un projet de reprise d’une filature, fondé de toute évidence sur une passion collective de tout un petit groupe de jeunes gens. On ne saura rien des motivations de chacun et c’est sans importance. On suivra plutôt le processus de longue et ardue reconstruction de cette utopie contrariée.
Dès la septième minute, on voit passer sur le visage de la compagne de travail de Loïc la souffrance du bras perdu de son compagnon. Ils sont pleins de courage. Chloé Jacquemoud ne nous présente aucun des personnages, aussi est-il difficile de les nommer individuellement. Il faudra se contenter de les découvrir dans l’action quotidienne et c’est très bien comme ça. Pas d’immixtion dans la vie privée. Ça ne fait pas moins d’humanité sous nos yeux.
Qu’est-ce qu’on voit ? Une filature à l’arrêt, dans un désordre apparemment inextricable. Le danger des installations désuètes est partout, mécanique, électrique… Et pourtant, progressivement, pas à pas, séquence après séquence, le travail avance secteur par secteur : lavage de la laine, nettoyage des énormes machines, remise en état des locaux…
La bande-son, faite parfois de musique à la guitare sèche et de bruits mêlés d’une mécanique rythmée, joue un rôle important quand il s’agit de prendre la mesure de l’avancée du projet décrite par une succession de séquences brèves sur les travaux en cours. Comme un sous-titre au film, les jeunes femmes nomment « le projet sans fin » qui est le leur. Elles en rient parce qu’à la 54è minute du film la filature est toujours à l’arrêt. La réalisatrice en off : « cette persévérance me questionnait ».
Les images sont très belles, en particulier par le fait qu’elles placent le spectateur en situation patiente de poser son regard sur des comportements, des attitudes, des gestes concentrés que rien ne prédestinait à la caméra.
Le sujet et les enjeux du film rappellent immanquablement cette autre réalisation sur une question du même ordre, « Les Agronautes » d’Honorine Perino, en 2017.
Guy Lavigerie
Les mots de Guy Lavigerie sur les films du Festival 2021:
Renés, de Daphné Mongibeaux
Une modeste maison au bord d’une voie ferrée. Un vieux couple qui s’aime, Marie-Jo et René. Lui fait son jardin et bricole. Elle puise son amour dans une foi religieuse et supersticieuse. Le film nous fait entrer chez eux et pourtant nous ne pouvons affirmer qu’il nous mette en lien avec eux. Il ne repose pas sur la narration mais sur des images dont certaines sont d’une beauté insolite. Nous sommes plus proches de ces images que de ce qu’elles nous disent de Marie-Jo et de René.
Je reste un peu sur ma faim, pas très convaincu par la rencontre mais séduit parfois par la focalisation sur des objets de l’intime cadrés comme en peinture.
Une place au soleil, de Clara Beaudoux
Un film tout en figures et en motifs extérieurs réalisés depuis une situation de confinement dans un appartement en Belgique. Car on devine sans difficulté qu’on n’est pas en France. Il y a une multiplicité d’images très belles, fenêtres, façades, figures humaines sur place publique (parfois accélérées sur le mode du « muet ») dans un jeu permanent d’alternance. Le plus souvent par grand soleil, d’où le titre à prendre au pied de la lettre (une place – publique – au soleil) et au figuré (chacun sa place au soleil). Comme il se doit, la continuité filmique est assurée par le son, principalement tiré des appareils radiophoniques ou télévisés domestiques qui donnent les informations quotidiennes sur l’épidémie de Covid. Vient le moment où le son radiophonique est remplacé par celui d’une conversation téléphonique avec une vieille dame qui met en doute l’idée de réaliser un film sur le confinement, trouvant le projet « étriqué », et délivre des conseils à la réalisatrice ; c’est un moment léger par son incongruité sans conséquence. Mais tout dans le film est beau et léger à la fois. Par exemple la vue de ce camion de nettoyage qui dessine un immense coeur avec de l’eau, parce que la place est déjà propre, donne parfaitement le contexte du confinement où la population invente des signes de reconnaissance dans l’adversité. Cependant ce film n’a rien d’erratique, au contraire, il est parfaitement composé à partir de tout le matériau réuni. Un film unique qui révèle l’invisible communauté d’une situation extraordinaire de la vie ordinaire.
Qui est là? de Souad Kettani
Une seule image du Maghreb, plan fixe en ouverture
du film, et l’on entend longuement comme le marteau d’un artisan. La suite se passe en France, dans un quartier de Villeneuve-La-Garenne. Le dispositif est simple et classique. Il repose sur le talent relationnel de la réalisatrice et de son équipe avec les personnes filmées. Nous sommes dans une salle de classe, d’abord dans un cours de philo où l’on pose la question du rapport entre la matière et l’esprit. Puis c’est un lycéen qui parle d’Aïcha, cet « esprit » qui hante la ville de Beni Mellal au Maroc : « Je ne l’ai jamais vue mais on en parle toujours ». Crainte de devenir fou,
de perdre la raison. S’en défendre en allumant les lumières le soir. La réalisatrice obtient des lycéens et lycéennes qu’elle interroge individuellement des réponses authentiques et belles. On accède ainsi à une vérité psycho-culturelle inédite dans le champ social rationnel. L’alternance des portraits réalisés en entretien avec les
images extérieures (parfaitement choisies et cadrées) de la cité qui entoure le lycée est très équilibrée. Les rares musiques utilisées arrivent à point nommé. On assiste à un moment de jeu entre amis (garçons et filles) pour exorciser la question en riant: « tu l’as déjà vu, Dieu ? » aussi bien qu’à la prononciation en arabe, par un lycéen en confiance, de trois sourates qui protègent… Mais encore à ce moment très fort où une jeune femme marche avec précaution dans la friche entre les immeubles qu’elle dit chargée de « morts », qu’elle ressent physiquement parce qu’elle a mal quand elle s’en approche. Le film de Souad KETTANI est une simple et belle réussite.
DANIEL Douala-Montpellier, de Maria Van munster
Raconter depuis Montpellier, la ville et son environnement, par des rails, un train, ses essieux… plus loin par les plages et la mer, les dunes, les barrières dans les dunes… par tous ces éléments de récit parcourus par des travellings parfaitement respirés… Raconter sans pathos le périple de Daniel parti de Douala, « échoué » au bout de trois ans à Montpellier avec sur le dos une obligation de quitter le territoire… Raconter avec des images forgées ici les épreuves endurées à Ceuta, avec la voix de Daniel, ses mots. De loin en loin ses mots comme épinglés, gravés dans du bois, peints sur un rocher, qui disent telles des pancartes brechtiennes entre deux séquences « je ne savais pas ce qui m’attendait » ou « ça m’a pris des mois »… Maîtriser le récit métonymique par l’image vivante sans se substituer à Daniel mais en l’accompagnant et en faisant de lui un sujet autonome dont nul ne peut partager la souffrance, c’est ce que réussit admirablement Maria Van Munster.
Sur Linkedin :